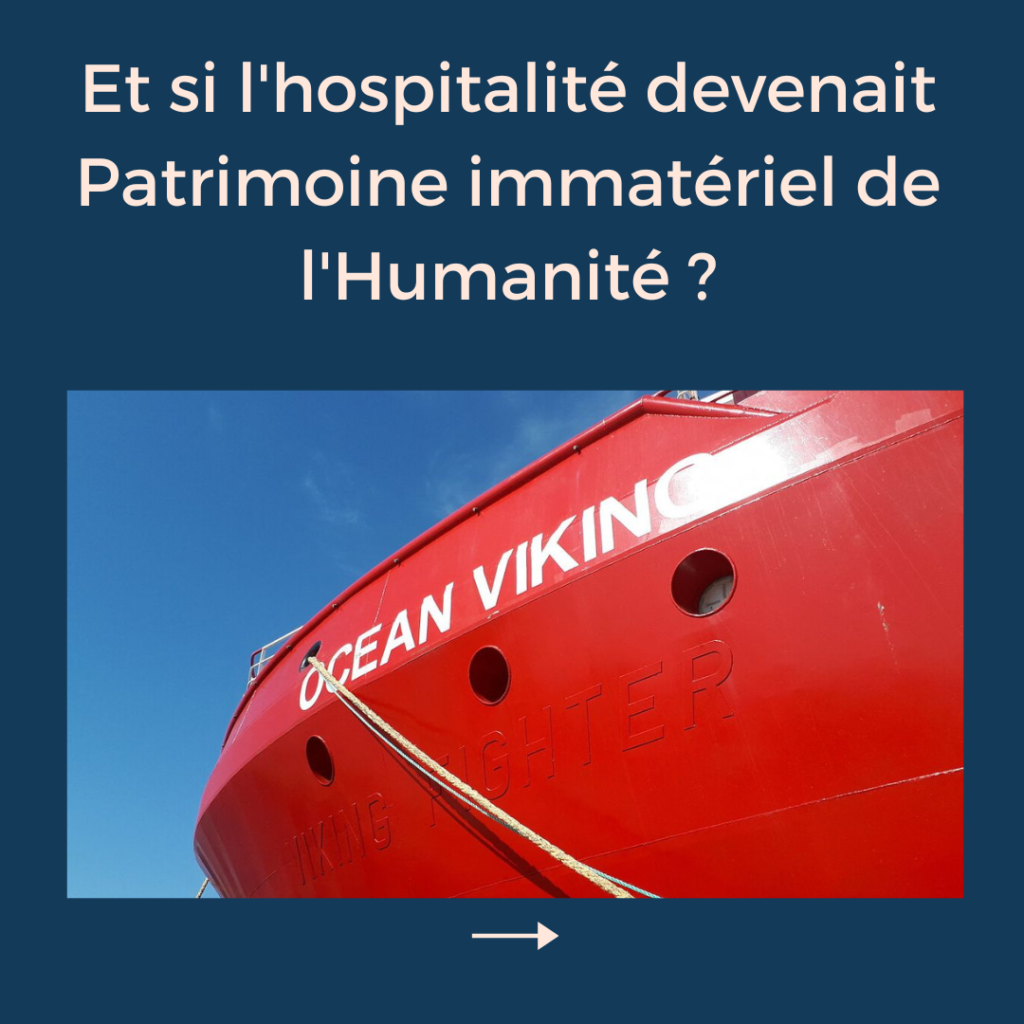
Et si l’hospitalité devenait Patrimoine immatériel de l’Humanité ?
Le 11 novembre dernier, l’Ocean-Viking, le navire humanitaire de SOS Méditerranée, accostait à Toulon après trois semaines d’errance à la recherche d’un port d’accueil. A son bord, 234 personnes, secourues en Méditerranée, des enfants, des femmes et des hommes en danger de mort dans leur pays ou à la recherche d’une vie meilleure semblable à celles de la majorité des Européen.nes. Le refus du gouvernement italien d’extrême droite d’accueillir l’Ocean-Viking, les propos de l’actuel ministre de l’Intérieur français et le plan d’urgence proposé par la Commission européenne le 25 novembre, remettent au cœur du débat la notion d’hospitalité. Sur ce sujet, LTET a pu rencontrer et interroger Sébastien Thiéry.
Depuis 2019, le docteur en sciences politiques Sébastien Thiéry travaille à faire inscrire l’acte d’hospitalité au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Il a fondé le Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines [PEROU] avec le paysagiste Gilles Clément pour mettre en place des recherches-actions sur les formes d’hospitalité qui s’inventent dans les confins des villes : les bidonvilles, jungles, squats ou encore refuges. Le PEROU coordonne actuellement avec des artistes et des partenaires culturels, la construction du Navire-Avenir, un navire de sauvetage qui sera mis à disposition des sauveteur.se.s de personnes en migration en Méditerranée et qui sera inauguré à Marseille en 2024.

LTET 1 : Le manifeste fondateur du PEROU en date du 1e octobre 2012 se conclut par ces mots : «Alors que se généralise une politique aussi violente qu’absurde, action publique aux allures de déroute n’ouvrant que sur des impasses humaines – expulsions, destructions, plans d’urgence sans issues, placements et déplacements aveugles, etc – , le PEROU veut faire se multiplier des ripostes constructives, attentives aux hommes, respectueuses de leurs fragiles mais cruciales relations au territoire, modestes mais durables. ». La naissance de PEROU est-elle née d’une colère, la vôtre ?
La colère est un peu plus lointaine que la création du PEROU, elle est sans doute ce qui m’y amène, mais je crée le PEROU pour tenter de la traduire autrement, pour tenter de donner des formes constructives à son expression. Je crois que j’ai été usé par des pratiques militantes antérieures, notamment avec les Enfants de Don Quichotte (2006-2007), consistant à hurler notre indignation (alors au sujet du sans-abrisme) et à créer les conditions d’un rapport de force avec les pouvoirs publics. J’en suis revenu en raison d’une efficacité moindre à mes yeux, voire du sentiment que colère et politiques de violence s’entretenaient d’une certaine manière : elles constituent en quelques sortes un théâtre politique où toutes les positions sont prévues, prévisibles, et donc sans issues. J’en suis revenu aussi, et peut-être surtout, parce que ces pratiques militantes consistant à exposer à grands fracas l’étendue du désastre ont, je crois, un effet d’abord étourdissant et accablant pour nous autres qui hurlons. Dénoncer le désastre, c’est peut-être l’énoncer une fois encore, lui faire un peu plus de place dans le monde, à travers nos mots, nos manifestations, nos banderoles. Avec le PEROU, j’ai voulu travailler à renverser la proposition, à dépasser ces formes usuelles d’expression de la colère en partant d’une attention nouvelle à ce qui a lieu : reconnaître dans des situations invivables le fait qu’elles soient vécues, reconnaître au milieu du désastre ce qui n’est pas de l’ordre du désastre, et s’en faire l’écho si puissamment que cela se mette à grandir. C’est une pratique renversée de l’acte militant : décrire ce à quoi nous tenons, ce qui nous fait tenir, et d’une manière si singulière que cela tienne et prolifère. Le travail que je développe avec le PEROU porte précisément sur cela : à quoi dire « oui » aujourd’hui, et de quelle manière afin que cette affirmation face éclore au centuple ce qui peut-être ne se présente que comme fragile promesse ? Mais, toujours, cela part du constat des impasses contemporaines, et des politiques de violences qui ne cessent d’aggraver les situations sous prétexte d’y répondre. C’est un constat que nous pouvons toutes et tous faire, tant il est élémentaire et confirmé mille fois : ça n’est pas en expulsant, détruisant, malmenant, terrorisant, éloignant, que l’on répond aux situations de grande précarité qui se présentent, et se multiplient, en partie d’ailleurs en raison de ces politiques de violences.
LTET 2 : Le PEROU crée ce que vous appelez des recherches-actions, pouvez-vous nous expliquer ce que sont ces dispositifs ?
J’ai créé le PEROU comme un outil de recherche, ce aussi parce que je revenais d’une histoire de militant qui m’avait entre autres choses décevantes appris que les acteurs publics ne savaient en général pas ce qui avait lieu, et donc encore moins ce qui pouvait avoir lieu. Ce pour une raison simple : c’est l’épreuve, la rencontre effective, la description minutieuse, et l’expérimentation qui constituent les savoirs, et c’est valable pour les sciences dures comme pour les politiques publiques. Travaillant d’abord sur les bidonvilles, il me semblait nécessaire de m’y rendre, de faire connaissance quotidiennement avec le dedans comme avec le dehors, avec les habitants comme avec les voisins exaspérés, de travailler autrement alors à relever ce qui s’y construisait, ce qui s’y affirmait, ce qui s’y inventait, et de tenter ensuite de définir, et d’expérimenter, d’autres formes d’action que celles répétées jusqu’alors, à savoir expulser et détruire. C’est le sens de la « recherche action » : reconsidérer l’action comme une méthode de production de savoirs, et s’efforcer effectivement de documenter précisément les processus d’action comme les effets, et transmettre cela pour inspirer d’autres actions ailleurs. Le PEROU a donc conduit de nombreuses actions, constructives notamment, mais en produisant toujours des rapports de recherche systématiquement transmis aux acteurs publics, aux acteurs associatifs, et enseignés dans les écoles où il m’a été donné d’enseigner, en écoles d’architecture notamment. L’idée est en somme de faire l’hypothèse que construire vaut mieux que détruire pour répondre par exemple à la situation problématique que représente un bidonville sur un territoire. L’idée est de suivre cette hypothèse, de se donner les moyens de l’éprouver, d’en mesurer les effets, et de transmettre cela aux acteurs publics, de les outiller, pour inspirer alors éventuellement d’autres politiques publiques que celles qui nous conduisent aujourd’hui dans les impasses que nous connaissons.
LTET 3 : PEROU est une association pluridisciplinaire au sein de laquelle des chercheurs en sciences sociales, architectes, artistes, urbanistes réfléchissent et travaillent ensemble à la construction des recherches-actions. En quoi votre approche pluridisciplinaire est-elle un atout ?
Nous travaillons sur des problèmes politiques lourds qui, comme tout fait social d’ailleurs, ne sauraient se réduire à un compartiment de la pensée. Rien ne relève exclusivement de tel ou tel champ disciplinaire, et tout problème public est un feuilleté de problématiques. Un bidonville par exemple est traversé par des problématiques juridiques, esthétiques, architecturales, urbaines, économiques, etc. Tout est toujours connecté : agir sur l’espace du bidonville par exemple, et prendre soin des lieux de vie en tant qu’architecte, c’est apaiser la situation et modifier ainsi la manière dont les habitants se projettent dans le temps, c’est contribuer à ce que les représentations se transforment et à ce que le voisinage par exemple franchisse le pas de ce qui jusqu’alors était perçu comme un cloaque innommable, c’est faire se multiplier des relations notamment économiques avec le territoire, c’est créer des perspectives autres que la sortie du bidonville sous la menace d’une pelleteuse. Alors le coordinateur des actions du PEROU que je suis s’efforce non seulement de réunir de multiples compétences pour chacune des actions que nous menons, mais de créer les conditions d’une interaction entre ces compétences. Malheureusement, les formations professionnelles sont ainsi faites que chaque discipline est consolidée dans sa propre solitude, et on fait croire par exemple à l’architecte que le bidonville pose une question d’architecture qu’avec les outils de l’architecture on peut traiter. Avec le PEROU, j’essaie donc d’aborder ces problèmes lourds en généraliste, non en spécialiste, en essayant d’accorder autant d’importance aux diagnostics divers, mais sans doute complémentaires, de chacun des professionnels réunis.
LTET 4 : Vous dites que ce qui fait d’une ville une ville, « ce sont des formes et pratiques de l’accueil et de la solidarité, des espaces et des gestes qui font l’hospitalité ». Or, si l’hospitalité se définit comme « l’action de recevoir chez soi l’étranger qui se présente, de le loger et de le nourrir gratuitement », on peut avoir le sentiment que la ville est au contraire, le lieu de l’exclusion. Pourquoi pensez-vous que ce qui définit une ville est l’hospitalité ?
Il faut sans doute distinguer d’une part le fait anthropologique de la création d’une cité, d’une communauté rassemblée dans et par la construction d’un territoire, d’un établissement humain consistant à bâtir une histoire commune et d’ainsi faire lieu, et d’autre part l’urbanisme, la science « moderne » de la construction planifiée de la ville, qui peut s’assimiler à un programme de contrôle. Quand je m’en réfère au geste inaugural, je fais référence à l’expérience anthropologique en affirmant qu’une ville est d’abord la conséquence de deux êtres qui se rencontrent et qui décident de ne pas se faire la guerre. Alors, l’acte inaugural relève bien d’un geste d’hospitalité consistant à reconnaître et accueillir un autre monde que le sien pour bâtir avec celui qui en est le représentant un territoire commun. C’est cette expérience qui est je crois ce que nous connaissons dans les formes multiples d’hospitalité qui se déploient aujourd’hui : quelque chose a lieu, fait lieu, à travers cette expérience très particulière, et bouleversante, consistant à faire d’un autre un hôte, qui nous renvoie à cet événement fondateur. Par contre, la science qui a pris le nom d’urbanisme, c’est à dire la programmation, par le dessin, le plan, la gestion des flux, de ce que nous nommons aujourd’hui « ville » ou « métropole », relève effectivement d’une vision guerrière : il s’agit de nettoyer les coins et recoins, d’ouvrir les artères à la vue des forces d’intervention, de neutraliser l’espace afin qu’il ne soit pas occupé. Cette science consiste en la gestion de l’espace au service de ses propriétaires qui se découpent le territoire en « parcelles » représentées sur le cadastre. Faire la ville aujourd’hui, c’est protéger cet espace cadastré, exclure celles et ceux qui ne sont pas productifs, c’est à dire qui n’enrichissent pas les propriétaires, voire qui en menacent les acquis. Il faut donc à mon sens retrouver le sens de cette pratique fondatrice, de cet art de faire lieu, et de bâtir donc des territoires d’expérience commune en contre-feu du développement urbain qui lui vise à nous diviser.
LTET 5 : Vous avez été pensionnaire de la Villa Médicis avec pour projet de faire inscrire l’acte d’hospitalité au Patrimoine mondial de l’humanité ce qui est un geste symbolique très fort. La requête a-t-elle des chances d’aboutir et quels seront les effets de cette reconnaissance ?

Reconnaître la beauté et la portée de l’acte d’hospitalité, c’est retrouver le sens de cette pratique fondatrice, mais c’est aussi prendre la mesure de son importance au regard des temps à venir : les bouleversements climatiques annoncent des mouvements migratoires extraordinaires ; faire l’hospitalité est donc une pratique décisive pour les générations à venir qui vont être confrontées à des crises sans commune mesure avec ce que nous connaissons aujourd’hui. Le PEROU s’est saisi de cette instruction auprès de l’UNESCO, mais seuls des Etats sont compétents pour conduire de telles requêtes. Nous travaillons donc le dossier aussi sérieusement que possible, et le déposerons à l’UNESCO pour rendre pensable et possible une telle perspective. Nous dirons alors aux Etats : il suffit de se saisir du dossier qui est déjà finalisé. Il n’est donc pas évident que la procédure soit finalisée, de manière régulière, mais ce qui m’importe c’est d’abord ce qu’instruire un tel dossier nous fait penser et nous fait faire. C’est ce qu’on appelle l’effet « performatif » d’un discours : énoncer une telle proposition, c’est déjà nous déplacer et nous faire agir autrement, nous autres qui portons ce discours. On a travaillé par exemple avec un collectif qui sert quotidiennement des petits déjeuners sur une place à Paris, et se raconter que ces gestes quotidiens ont la portée d’un patrimoine mondial, et y croire à force de se le raconter, c’est peu à peu donner une tout autre envergure à ce petit déjeuner, une tout autre puissance à ce geste quotidien, un tout autre souffle au collectif lorsqu’il se retrouve devant les acteurs publics par exemple. L’idée, c’est aussi de faire que les effets d’une telle procédure adviennent dès à présent, par le simple fait de se dire que l’on va déposer à l’UNESCO ce dossier, dans lequel seront décrits notamment les actes de ce collectif qui offre des petits déjeuners quotidiens aux réfugiés à Paris.
LTET 6 : Depuis 2020, le PEROU, associé à des artistes et des partenaires culturels tels que le Centre Pompidou-Metz, Friche Transfert et le MUCEM, construit un navire pour l’avenir qui sera un navire de sauvetage mis à disposition des sauveteur.se.s de personnes en migration en Méditerranée. Quelle est la genèse de ce projet si particulier ?
Ce projet de navire est une des conséquence « performative » de l’instruction conduite auprès de l’UNESCO. La procédure implique de définir l’acte d’hospitalité, de produire des textes, des images, un film, mais aussi de définir en quoi peuvent consister des dispositifs de sauvegarde de l’acte d’hospitalité : que mettre en œuvre pour protéger les actes et les transmettre aux générations à venir ? Parmi ces actes, il y a les gestes des marins sauveteurs et de celles et ceux qui soignent les rescapés à bord des navires de sauvetage aujourd’hui. Alors construire des navires spécifiquement conçus à partir des gestes, comme des outils permettant qu’ils se déploient plus et mieux, c’est contribuer à leur protection. En outre, ces navires pourront être transmis aux générations à venir, et les gestes pourront ainsi se perpétuer. Il faut considérer donc que de tels navires sont des « conservatoires de gestes ». Nous aurions pu nous contenter de décrire cela dans le formulaire dédié à la procédure, et réclamer que l’UNESCO contribue à la construction d’une telle flotte. Mais nous nous sommes mis à décrire mieux ces navires, à solliciter des architectes navals, des designers, des rescapés, des marins sauveteurs de SOS Méditerranée, des soignants des hôpitaux de Marseille, et nous avons dessiné, créé des maquettes, et petit à petit créé les conditions de réalisation d’un premier navire, le Navire Avenir. Voilà un bel exemple d’effet performatif : en nous adressant à l’UNESCO et lui décrivant notamment le navire à construire, nous finissons par le construire. D’une certaine manière, la meilleure façon de décrire le navire à construire est de le construire, comme une description en volume, à échelle 1. Dans ce chantier, nous avons alors mobilisé de multiples lieux culturels qui nous soutiennent dans le travail de conception. Cela fait un peu plus de deux ans que nous y travaillons, à Marseille surtout, à l’interface d’une cinquantaine d’écoles et équipes de recherche, et nous avons désormais un dessin très précis de ce premier navire européen de sauvetage en haute mer, qui sera un catamaran de 69 mètres de long sur 22,50 mètres, et dont la construction doit coûter à peu près 20 millions d’euros. Nous avons aujourd’hui à trouver cette somme colossale, en espérant pouvoir lancer le chantier l’année prochaine, chantier qui va prendre encore 1 an et demi. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour pouvoir inaugurer le Navire Avenir à Marseille fin 2024 voire début 2025, et le mettre alors à disposition de SOS Méditerranée, et des générations futures.
Flora Loilier
Plus d’informations sur :
https://www.perou-paris.org/Manifeste.html
https://www.perou-paris.org/Actions.html#En%20M%C3%A9diterran%C3%A9e
https://www.villamedici.it/fr/residences/sebastien-thiery/